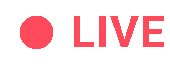Son nom Souley sonne symphonie, parce qu’il a une histoire qui fleure l’art dans tous ses pores et ses ports. C’est dire que parler de votre invité people du jour revient à explorer des sons, mais aussi des habits parlants et des attitudes innovantes.
Pair du Pbs, père du hip hop galsen, Souley est un témoin et un legs d’un passé fécondant mais aussi l’espoir d’un avenir prometteur. Aussi tel Janus (Dieu grec à double visage), il est un regard double de l’évolution de l’art sénégalais dans sa polysémie et dans son interconnexion. Et c’est cela qui définit mieux le personnage de Baye Souley dont la personnalité s’enrichit de sa porosité aux apports intrinsèques et de sa générosité à donner du sien pour faire éclore le potentiel des autres sur qui il pose un avis bienveillant de critique objective. Lisez-le pour le déguster par l’intellect et l’affect
La danse, la musique, la mode, le tout dans une seule carrière, comment avez-vous réussi à concilier tout ça ?
Je me considère comme quelqu’un d’assez versatile. Comme j’aime le dire, je vois l’art de façon panoramique. Pour moi chaque discipline est liée aux autres : elles dialoguent entre elles et s’enrichissent mutuellement. J’ai commencé par la danse notamment avec les frères You avant même l’aventure de Positive Black Soul. En parallèle, je créais aussi nos tenues de scène. Ma toute première création c’était pour la danse j’avais récupéré des banderoles de manifestations de mon grand frère journaliste, que j’ai découpées pour en faire une ceinture….Dans l’art tout est connecté, et tu ne peux pas laisser une discipline de côté au profit d’une autre.
Quel est selon vous l’impact de positive black soul sur le développement du hip-hop africain ?
Je crois que la jeune génération ne peut pas vraiment réaliser l’impact qu’a eu Positive Black Soul ici au Sénégal, parce que ça remonte à plusieurs décennies. À l’époque, l’impact était énorme. Je me souviens de notre tournée à Madagascar à l’aéroport il y avait des comités d’accueil parce que les gens nous connaissaient grâce à la radio. C’était pareil au Congo, au Cameroun, en Afrique du Sud… partout nous avons laissé une empreinte. Quand les jeunes Africains nous voyaient, ils se disaient : « Ok, c’est possible ! ». On a transmis un souffle d’espoir, une fierté, et ça a marqué toute une génération. Beaucoup de jeunes artistes ont suivi nos pas, dans plusieurs pays. L’impact de PBS, ce n’était pas seulement musical, c’était aussi socio-culturel.
Pourquoi avoir choisi le nom « bull doff » et que révèle-t-il de la philosophie de la marque ?
J’ai longtemps cherché un nom j’en avais plusieurs en tête mais souvent avec une connotation anglophone mais ça ne me convainquait pas. Quand l’idée de « Bull Dof » m’est venue, j’ai tout de suite su que c’était le bon. C’est un slogan intemporel, qui ne se démode pas. « Bull Dof » ça veut dire avant tout : « nekal nit » pour dire sois lucide, reste conscient. Ne sois pas naïf face aux choses et aux gens, prends toujours le temps d’aller en profondeur, de creuser. J’aime donner cette image pour l’exprimer : je me tiens face à la mer et j’imagine ce qu’il y a au fond, invisible à la surface. Et c’est cette philosophie que je veux transmettre à travers la marque.
De quelle manière utilisez-vous la mode comme outil de revendication sociale ?
Il m’arrive d’utiliser la mode pour revendiquer quelque chose, mais pas tout le temps. Pour moi, la mode n’est pas forcément un acte révolutionnaire. En musique ou en danse, je crée surtout selon mon inspiration et mon mood (état d’esprit du moment), il n’y a pas une commande intellectuelle. Il m’est arrivé, par exemple, d’utiliser le bonnet Cabral dans un défilé comme symbole revendicatif, mais ça s’arrêtait là. Au fond, la mode reste d’abord un moyen de s’habiller et qui dit vêtement dit aussi beauté et bien-être.
En quoi votre travail artistique contribue-t-il à promouvoir une « Afrique consciente » ?
Je dirais plutôt le fait d’oser créer sans complexe. Quand un Coréen, un Américain ou un Français voit mon travail, il doit se dire que c’est une création made in Africa, made in Sénégal mais sans que ça tombe dans l’exotisme. Rien que ça, c’est déjà une forme de conscience. Et puis je n’ai pas besoin de prouver aux autres que je suis conscient : ça se ressent dans ce qu’on dit, dans la manière de défendre nos idées et dans la qualité de nos productions. Comme disait Wole Soyinka : « Le tigre n’a pas besoin de proclamer sa tigritude. »
Quel a été jusque-là votre moment de plus grande fierté dans votre carrière ?
Il y a eu beaucoup de moments dont je suis fier. Par exemple, quand j’ai sorti mon premier album solo rap « Ndol » en 2004. Ce n’était pas un simple projet musical mais toute une histoire avec des lieux, des personnages, une chronologie… J’étais très fier parce que ce n’était pas facile. Il y a aussi eu les anniversaires de PBS, notamment celui à Daniel Sorano, avec presque toute la famille présente. Ma petite sœur était même montée sur scène pour danser avec nous. Je garde aussi en mémoire le premier grand défilé de la marque « Bull Dof », où toute la famille était là pour voir le résultat d’un long travail. Et bien sûr les projets avec Defmaa MaaDef : à chaque fois qu’on voit le travail accompli, on ne peut être que fier. J’espère qu’il y aura encore beaucoup d’autres moments comme ça.
Quel regard portez-vous sur la nouvelle génération d’artistes sénégalais ?
Je trouve que c’est une très bonne chose de voir cette nouvelle génération, que ce soit au niveau national ou international. Au Sénégal, on a de vrais talents. On a des artistes comme Mia Guissé, Ndakhté, une artiste que je trouve incroyable en live, avec une vraie fraîcheur dans sa proposition rien à voir avec ce qui se faisait avant. Dans le hip-hop, par contre, je trouve que ça stagne un peu depuis la génération de Ngaaka et Dip : il y a des intentions, des promesses, mais rien qui ait vraiment explosé. Il y a aussi VJ, que je ne mets pas vraiment dans la case rap : lui c’est plus ouvert, entre pop urbaine et envolées mbalax. J’adore son style et ça marche très bien, pas seulement au Sénégal, mais aussi en Gambie, en Mauritanie, en Guinée, au Mali. Il a ce potentiel pour aller plus loin que beaucoup de rappeurs. Samba Peuzi aussi j’aime beaucoup son côté musical. Et puis il y a des artistes comme Ashs The Best, Obree Daman, Saliou Jahm, Amadeus… eux, il faut les pousser, parce qu’ils ont vraiment le potentiel pour percer à l’international. Et puis il y a Defmaa MaaDef, un vrai cas d’école. On est sur une bonne dynamique et je veux même vulgariser cette approche avec d’autres artistes.
Et si vous nous parliez de Defmaa MaaDef et des aspects du projet ?
Avec Doudou Sarr (Fondateur et initiateur du Dakar Music Expo), on avait fait un constat : pourquoi la musique sénégalaise avait du mal à s’exporter ? À partir de là, on a construit tout le modèle de Defmaa MaaDef. L’idée, c’était de créer une proposition capable de tourner sur les grandes scènes internationales. On voulait un groupe de filles, avec une identité qui dépasse le rap, en mélangeant des sonorités plus ouvertes : électro, afro, mais aussi nos racines avec les percussions, le tassu, les rythmes du Fouta à la Casamance….Dès qu’on présente l’idée, ça attire la curiosité. Les gens qui ont connu Daara J ou PBS comprennent tout de suite l’esprit, mais version féminine, et ça les séduit. Après, il fallait assurer derrière : avoir un vrai spectacle solide, une créativité dans la musique, le visuel, les silhouettes, le mélange entre rap, chant, urbain et traditionnel. Ça fait presque 4 ans qu’on travaille là-dessus et c’est ce qu’on essaie de maintenir : une qualité artistique de haut niveau.
Après 4 ans de projet, où en êtes-vous avec le groupe ?
Aujourd’hui, on peut être satisfait du chemin parcouru. On a déjà fait une cinquantaine de concerts, participé à des festivals, joué dans des salles un peu partout dans le monde. Rien que ça, c’est une réussite. Au départ le projet était pensé uniquement pour le live mais maintenant on passe à une nouvelle étape : sortir un album d’ici la fin de l’année et renforcer notre présence au Sénégal. Parce que jusque-là on a surtout construit le groupe à l’international, sans avoir sorti d’album. On n’a publié qu’un EP de quatre titres sur les plateformes, et malgré ça, on a pu exister et la suite c’est donc de sortir l’album et d’être plus visibles ici, au Sénégal.